Lien: http://www.juanasensio.com/archive/2018/09/14/le-verbe-dans-le-sang-de-leonardo-castellani.html
Le Verbe dans le sang de Leonardo Castellani
(Éditions Pierre-Guillaume de Roux, introduction, choix des textes et traduction de l’espagnol par Érick Audouard)
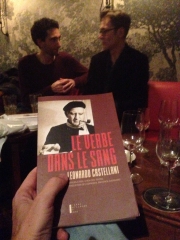
Acheter Le Verbe dans le sang sur Amazon.
C’est parce qu’il attend impatiemment l’Apocalypse, tout en ne cessant de se plaindre de la bêtise et de la dégénérescence de notre époque que Leonardo Castellani ne retient, comme Léon Bloy auquel il a consacré une belle note, aucun de ses coups. Ne trouve-t-on pas, dans un ouvrage intitulé Les Chansons de Militis dont le seul titre nous laisse augurer quelques réjouissantes tournées de baffes, l’affirmation selon laquelle il est un homme en guerre ? Ne savons-nous pas que ses dernières paroles auraient été :«Me rindo», autrement dit «Je me rends» ? Ailleurs, ne nous parle-t-il pas avec fort peu d’aménité de la démocratie, dont il oppose la faiblesse intrinsèque à la force de la monarchie chrétienne qui, «en dépit de ses péchés et de ses crimes, fit les cathédrales et les épopées» ? (voir La démocasserie libérale, p. 165).
Érick Audouard, dans sa très belle introduction (1), affirme de ce «curé maudit», «homme à l’envers dans un monde à l’endroit» (p. 14) (curieusement, nous aurions affirmé l’inverse !) manifestant une «intolérance absolue au vague dans les choses de l’esprit» (p. 17), ou encore «né pour forcer son temps à reconnaître l’absolu chrétien» (p. 15), qu’écrire «des livres, donner des cours ne suffit pas, il faut descendre de sa chaire dans la fosse à purin, dans les lieux louches où turbine à plein régime, avec une efficacité prodigieuse, cette industrie à polluer toutes les sources de la pensée qu’on appelle la presse» (p. 24). D’ailleurs, servant au mieux la pensée de celui qui sans cesse fut rejeté par ses supérieurs jésuites, dont il se venge en pointant la médiocrité de la Compagnie de Jésus dans un magnifique article sur Gerard Manley Hopkins, Audouard lui-même n’hésite pas à se montrer offensif en rangeant celui dont il sera définitivement l’introducteur en France, cet homme d’un bloc d’intelligence, d’humour et de volonté «qui cria de toutes ses forces dans les oreilles ensablées du désert argentin» comme me l’a écrit Érick Audouard dans sa dédicace, «et dont la voix résonne ici pour la première fois dans le nôtre», dans la catégorie assez peu recommandable de ceux qui servent la vérité, et qui par conséquent toujours subiront les railleries de ceux qui se servent de la vérité : «les premiers n’ont pas d’endroit où reposer leur tête, les seconds s’établissent. Les seconds sont normaux, les premiers sont exceptionnels» (p. 19).
Insupportable Castellani qui nous réveille en hurlant à nos oreilles, qui accable, comme le fit le Christ, les pharisiens, qui, dans un autre ordre d’idées (encore que), raille la verroterie dans laquelle le prestidigitateur Borges parvient tout de même à glisser quelques authentiques diamants, qui moque Wells mais aussi Anatole France (2), Albert le Suisse (Albert Schweitzer) ou Teilhard de Chardin et loue au contraire le dernier Oscar Wilde, qui gueule encore, seul ou presque contre tous et d’abord contre ses supérieurs mithridatisés contre toute forme d’art véritable, depuis la perte qu’est notre époque : «Il n’y a pas lieu de discuter avec ceux qui n’en partagent pas l’évidence; croupions au vent et becs dans le sable, les autruches se voient un bel avenir. Jamais la volonté d’ignorer n’aura été aussi forte, jamais elle n’aura été aussi satisfaite. Sous la pression de l’ignorance volontaire, le sens commun a basculé dans l’insensé collectif, et notre pauvre langage est tellement corrompu qu’il est presque hors d’usage» a ainsi raison d’écrire notre traducteur et préfacier, qui ne fait que suivre attentivement la leçon de Leonardo Castellani qui lui, discrètement mais avec une constance qui ne peut être le fruit du hasard, affirme que nul «n’ignore que tous les mots ont été démocratisés par notre époque démocratique» (Albert le Suisse, p. 228). Et quand on sait comment l’auteur se moque de la démocratie qu’il compare, au terme d’une hilarante parodie d’un dialogue socratique (voir Le nouveau Socrate, pp. 219-22), non seulement à une autruche mais au nazisme qui est son plus évident frère jumeau au terme de cet exercice de raison raisonnante poussée au bout…
Il est à ce titre étonnant de constater que lui aussi, comme Baudouin de Bodinat, stigmatise la défiguration du monde à laquelle l’homme se livre, tel passage éclairant pouvant même condenser utilement les phrases inutilement savantes, parfois obscures, de cet auteur : «La chair, désanctifiée, s’attriste, tandis que l’air devient irrespirable, comme si nous avions interdit à l’Esprit de souffler. La pollution industrielle et le «réchauffement climatique» n’y sont pour rien : seul imbécillité et le gel des cœurs ont rendu possible la grande clinique en quoi nous tâchons désormais de changer la terre après l’avoir défigurée» (p. 46) alors même que, «phase terminale de l’humanisme, le mal nommé «transhumanisme» culmine au sommet de ce long procès qu’aura représenté notre expulsion de Dieu» (p. 47). Ailleurs (Vous avez dit révolution ?, p. 157), Castellani affirme qu’il y a «un tel chaos dans le langage et une telle purée de pois dans l’époque» que la mission du «vigile chargé de veiller sur les concepts» qu’il déclare être «devient chaque jour plus terrifiante» et c’est dans ce même article qu’il affirme que «le terrible phénomène de «la confusion des personnes», déploré par Dante, s’est propagé en prenant des proportions universelles : «il ne reste plus aucune doctrine qui ne puisse être falsifiée depuis la falsification de la doctrine catholique elle-même dans cette monstrueuse hérésie appelée modernisme» (p. 158, l’auteur souligne).
C’est dans ce monde que sonne la voix railleuse, érudite et méchante de Leonardo Castellani, voix «puisant son timbre et sa bonté au saloir des Évangiles» (p. 48), voix qu’il faut donc à présent relayer en espérant nous aussi qu’elle ait le «coffre nécessaire pour résonner dans une époque aux enjeux d’autant plus grands que les hommes y sont petits» (p. 49). Ainsi planté, le décor a de quoi épouvanter, mais nous n’avons encore rien vu, car il s’agit maintenant d’écouter ce que ne cesse de nous répéter celui qui proclame l’aridité totale et le désespoir de notre époque, sur les brisées d’Hilaire Belloc (cf. p. 57), désespoir d’un «monde tombé des mains de Dieu» et qui, conséquemment, «agonise et crève à la pelle parce qu’il lui manque une raison de vivre» (p. 63, Le désespoir païen, l’auteur souligne), alors même que les hommes semblent avoir oublié quel en était le Père, puisque, pour «le monde moderne, Satan est mort, et les poètes ne craignent plus d’utiliser sa chair et ses tripes pour farcir leurs poétiques andouilles» (p. 121, Papé Satán, papé Satán aleppe). «Depuis Blake jusqu’à Dostoïevski, écrit Castellani dans un autre article (Perception du démoniaque), depuis Baudelaire jusqu’à Kierkegaard, les grands hommes de lettres du XIXe siècle ont vu et senti avec une grande lucidité le phénomène de la perversité, c’est-à-dire du démoniaque» (l’auteur souligne), et cela alors même que notre époque a tout abâtardi, «que le criminel s’est désormais transformé en malade, le pervers en individu blessé par la vie, le possédé en hystérique ou en épileptique», l’objectif ayant été de «sauver le diable avec élégance, en le fardant et en le maquillant» (p. 142).
Ce monde qui ne croit plus à rien ni en quoi que ce soit, Dieu ou diable, se voit déserté par la grâce qui, «de nos jours, avec l’empoisonnement de ses sources naturelles, ne fonctionne plus que de manière souterraine et quasi sauvage» (p. 113, La geôle d’Oscar Wilde), par exemple en touchant, en foudroyant peut-être, le Wilde sortant de prison et qui y comprit que, «en tant que poète, la douleur de tous, c’est-à-dire la douleur de l’homme, était amenée à se refléter à l’infini dans les facettes de son âme cristalline» (p. 111). S’il est moqué, exclu, ignoré puis oublié, Leonardo Castellani ne se prive pas de nous avertir que ses frères d’armes sont puissants, même si, à la différence de ces derniers, lui ne semble pas avoir découvert la foi «à travers le péché» : «si le pharisianisme» oppresse et persécute Charles Baudelaire, Oscar Wilde et Léon Bloy, «c’est pour la simple raison qu’ils se refusent à le servir, en vertu du privilège de l’artiste, de son droit souverain à la liberté, privilège et droit dont ils se sont faits les douloureux défenseurs, tout en sachant qu’ils n’avaient pas les nerfs assez solides pour gagner ce combat» (p. 105).
Entendons-nous bien sur ce mot de liberté, qui ne doit certes pas être compris au sens rousseauiste du terme, puisque, nous le savons, l’art meurt de libertés et vit de contraintes, ce que Castellani affirme non seulement en moquant Rousseau mais en évoquant Leopoldo Lugones disant que «seul le mauvais poète exige le vers libre», alors que «le bon poète multiplie les attaches de son matériau pour rendre plus visible le triomphe de la forme, en quoi consiste la beauté» (À l’école de Rousseau, p. 153). Ironiquement, Castellani ne goûte guère ce parangon de la conquête de la liberté selon les modernes qu’est la Révolution française, qui lui permet de lancer une vacherie à la tête des socialistes : «Cet abus de langage s’est clairement manifesté quand un socialiste déclara un jour à Donoso Cortés : «Jésus-Christ fut le premier révolutionnaire du monde» – ce à quoi l’orateur espagnol répondit : «Certes. Mais Jésus-Christ ne versa pas d’autre sang que le sien.» Si Donoso Cortés, en plus d’être orateur, avait été philosophe et saint, avec une petite dose d’homme d’action», poursuit ironiquement Castellani, «il lui aurait répondu plus laconiquement : «Diable !», avant de lui flanquer une gifle dans la figure, le libérant ainsi d’une erreur, et libérant à jamais l’humanité de cette stupide manie de mélanger les concepts qui est propre aux orateurs. Propre aux orateurs socialistes, toujours; aux autres, trop souvent» (Vous avez dit révolution ?, p. 159).
Dans un monde «devenu frénétique» (Charles Quint et l’imprimeur, p. 187), cette attention au sens des mots, «ces maudits mots fumeux qui sèment la confusion» (L’ultime hérésie, p. 175), est du reste constante dans l’ensemble des textes de Leonardo Castellani, la corruption du langage, son chaos («Il y a un tel chaos dans le langage et une telle purée de pois dans l’époque», Vous avez dit révolution ?, p. 157), dus à l’explosion journalistique (3) elle-même fruit de la reproduction sans limites des mots (4), étant probablement à l’origine de ce que l’auteur appelle la «falsification de la culture», falsification contre laquelle nous ne pouvons que faire pénitence, autrement dit, d’un point de vue étymologique, changer d’esprit, se mettre à voir les choses telles qu’elles sont, dire et penser profondément la vérité. Prendre la peine d’approcher la vérité. Car on ne peut l’approcher sans peine» (Professionnels, p. 183, l’auteur souligne).
Il y a autre chose que cette falsification de la culture : il y a «le risque de la perversion interne du christianisme» (Culture ou culturopathie, p. 173, l’auteur souligne) que Castellani rapproche du risque pointé par Kierkegaard (qu’il nomme comme il le prononce, soit Kirkegord) concernant un glissement sur le seul plan esthétique puisque, après tout, comme l’auteur l’écrit non sans beaucoup de malice, le «Christ n’est pas mort sur la croix pour qu’existe un jour La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach» (Ibid., p. 172). Nous pourrions d’ailleurs évoquer plus longuement ce que Castellani écrit sur Kierkegaard, qu’il a comparé dans un livre encore inédit dans notre langue à saint Thomas d’Aquin, Kierkegaard (pardon, Kirkegord), qualifié d’«authentique Hamlet», «vivant signal qu’il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark», objet d’une belle méditation à valeur générale que nous pourrions résumer par cette sentence aussi admirable que juste : «Un homme seul n’a pas le pouvoir de sauver une société de la ruine, mais Dieu peut faire d’un seul homme le signe qu’une société court à sa perte» (Le geste de Kirkegord, p. 236).
Ailleurs, Leonardo Castellani évoque ce qu’il nomme la fiction du catholicisme, qu’il définit comme étant le libéralisme qui, «avec les faux dogmes de ses fausses libertés, est un protestantisme larvé et un catholicisme adultérin» (Une bonne leçon, p. 232). Cependant, et parce qu’il nous faut bien conclure ces quelques lignes qui, je l’espère, donneront à mes lecteurs l’envie de découvrir ce diable d’auteur, la phrase que nous avons notée à propos de Kierkegaard nous permet d’aborder la dernière partie du volume si intelligemment conçu par Érick Audouard, intitulée Nouvelles de l’Apocalypse. Cette partie pourrait nous faire croire que, obsédé par l’ouverture du septième sceau, Castellani serait un de ces incurables pessimistes nous alertant de la catastrophe qui nous guette, sans bien sûr consentir à se retrousser les manches, ce qui est tout autre chose que de broder au petit point, comme Baudouin de Bodinat le fait, sur le thème du monde qui court à sa ruine, qui est à vrai dire déjà ruiné, raison impérieuse pour laquelle il ne faut pas manquer d’écrire plutôt que de se taire ou d’agir.
Or, la vie même de Leonardo Castellani nous montre qu’il est absolument tout ce que l’on voudra, un puissant érudit, un homme de combat, un esprit radicalement libre, un emmerdeur qui aura empêché ses collègues de prier en rond, mais qu’il n’est assurément pas un de ces universitaires planqués qui montrent amplement leur courage en signant des pétitions contre des morts comme Charles Maurras, morts pourtant plus vivants que ces sépulcres blanchis, ce qui veut donc dire que Leonardo Castellani n’est évidemment pas l’un de ces innombrables semi-lettrés qui, lorsqu’ils «règnent sur le domaine des lettres», ne concourent qu’à permettre à la mystification de se répandre inéluctablement et à se propager «de façon épidémique» (Semi-lettrés, p. 225). N’oublions pas que cet homme a été véritablement harcelé, moqué et même cassé, le terme n’est hélas point trop fort, par sa hiérarchie de la Compagnie de Jésus, et que ce genre d’expérience suffirait parfaitement, puisqu’il ne l’a point brisé, à forger un caractère moins trempé que celui de Leonardo Castellani, veilleur annonçant «l’époque parousique qui vient» (Demain, Thomas d’Aquin, p. 243) laquelle, si nous ne savons par définition ce qu’elle est, a fort peu de chances d’être similaire au rêve inepte de ces Toynbee, Wells ou Teilhard de Chardin appelant de leurs vœux une «super-fédération des nations en une seule puissance planétaire», une «palingénésie totale de l’univers visible, œuvre de la science moderne» (Vision religieuse de la crise, p. 250), cauchemar d’une société aseptisée que le monde moderne «tente fiévreusement de […] construire sans Dieu : en s’apostasiant, en niant le Christ, en abominant cette ébauche d’unité qui vit le jour en Europe sous le nom de chrétienté, en opprimant et en persécutant férocement jusqu’aux principes essentiels de la nature humaine, à travers la suppression revendiquée de tous les liens et de toutes les appartenances (familiales, patriotiques, etc.)» (Ibid., p. 252).
Ces dernières pages, qui une nouvelle fois citent d’abondance Kierkegord qui a semblé à si juste raison fasciner Castellani, évoquent le martyre, autrement dit le fait de concilier «le devoir de parler», «l’impossibilité physique de se taire» avec le fait de défendre non point sa vérité mais la vérité, par le biais d’une démarche paradoxale, donc scandaleuse aux yeux des badauds que nous sommes, le grand philosophe danois assurant qu’il fallait «se rendre infâme», s’humilier en somme, «se rabaisser en dessous de celui qui se trompe» (La provocation, p. 270). Autrement dit, nous avons, par ces temps d’Apocalypse, bien moins besoin de phraseurs que de témoins, ce que fut, sans le moindre doute, Leonardo Castellani.
Notes
(1) Entre parenthèses et sans autre mention, les pages indiquées renvoient à la seule introduction d’Érick Audouard. Je mentionne dans tous les autres cas le titre choisi par le traducteur, qui ne correspond pas toujours aux titres originaux des articles de Castellani. Je signale enfin quelques menues fautes, comme l’absence d’une parenthèse fermante en haut de la page 98 ou encore : «Qu’as-tu fait du l’Étoile du matin» (p. 121), «Même Mgr Piccirilli peut accéder la foi» (p. 143) et «non moins qu’un grand plume» (p. 251).
(2) «Ôtez-leurs les éclats de haine et de luxure qui servent maladroitement à les galvaniser, les œuvres d’Anatole France sont mortes. Ce sont des faïences, des mosaïques, des porcelaines, ce que vous voulez : elles sont froides. Sa pensée reste femelle, passive, elle ne féconde rien : elle est engrossée par ce que lui injectent les livres. Il n’a créé aucun personnage, n’a pénétré aucune existence, n’a épousé aucun amour, n’a maintenu aucune conviction dont son esprit irrémédiablement épidermique qui se contentait de badiner dans le monde multicolore des images. Ses héros sont des pantins, et la trame de leurs agitations n’est qu’ironie, raillerie perpétuelle, sûre d’elle-même et blasée, c’est-à-dire tout le contraire d’une philosophie» (p. 124, l’auteur souligne, in Anatole philosophe).
(3) Et c’est donc en jouant sur le sens des mots, en rappelant leur origine, que Castellani va nous rappeler quelques évidences comme celle-ci : «l’information se résume désormais aux nouvelles», lesquelles sont «destinées pour la plupart à duper, à désorienter, à anesthésier. En latin, informer signifie donner forme, ce qui revient à donner l’être. Donner une forme accidentelle qui suppose l’existence d’une forme substantielle. Pour être informé, il faut d’abord être formé» (Professionnels, p. 183).
(4) Voir à ce sujet l’excellent texte intitulé Charles Quint et l’imprimeur qui n’est autre que le fameux sieur Bonmont ou Gutenberguen venu réclamer de l’argent au potentat en échange des bienfaits de son invention qui permettra de reproduire «des livres qui ne seront écrits qu’avec des bouts d’autres livres», et même des «quantités faramineuses de livres dont les titres seront empruntés à d’autres livres, des bibliothèques entièrement composées de livres composés de listes d’autres livres !» (p. 186).